Ecrit par Tony Ferri. Publié dans > |, À la une, Education, Faits de société, Politique
Mots-clés : dragan brick, Dragan Brkic, économie, foot, football, footness, people, soccer, sport
Après ses deux précédents romans phare à portée autobiographique que constituent Le Petit Noir des Balkans (Éditions Publibook, 2004) et Prière d’insérer (Éditions Goater, 2009), Dragan Brkić nous livre ici, avec Footness, un troisième roman assurément original et de très bonne facture. Au moyen d’un savant mélange percutant, Dragan Brkić nous invite en effet, par ce livre aux accents de polar serti de suspense, à nous plonger au cœur d’une intrigue nauséabonde, dont le noyau s’articule autour de la méticuleuse et complexe collusion entre, d’un côté, l’univers du football et, de l’autre, le monde de la finance, les loges secrètes, la classe politique.
 Ménageant un suspense haletant, apportant progressivement, et à point nommé, l’éclairage dont a besoin le lecteur, l’intrigue déploie, au long du déroulement du récit, toute son efficacité et toute sa force de persuasion, de sorte que l’on ne manque pas d’être continûment happé à la lecture par le vertige des manœuvres et des arrangements conduits en sous main par ceux qui sont à la tête de ces puissants et nébuleux réseaux politico-financiers – ainsi de celui nommé « Footness » -, et que ce n’est, au fond, qu’au terme du livre que s’agencent les derniers éléments essentiels du puzzle.
Ménageant un suspense haletant, apportant progressivement, et à point nommé, l’éclairage dont a besoin le lecteur, l’intrigue déploie, au long du déroulement du récit, toute son efficacité et toute sa force de persuasion, de sorte que l’on ne manque pas d’être continûment happé à la lecture par le vertige des manœuvres et des arrangements conduits en sous main par ceux qui sont à la tête de ces puissants et nébuleux réseaux politico-financiers – ainsi de celui nommé « Footness » -, et que ce n’est, au fond, qu’au terme du livre que s’agencent les derniers éléments essentiels du puzzle.
Autant dire qu’avec ce livre, Dragan Brkic fait vivre au lecteur une histoire foisonnante chargée d’aventures singulières et de rebondissements incessants. Au programme, notamment : un riche voyage à La Barbade, en Martinique, à Londres… ; la découverte de personnages aux visages truculents et variés, comme, par exemple, Pascal, l’honnête professeur de français, ou Garance, la maîtresse à la personnalité plutôt mystérieuse, ou encore l’inquiétant Christian Lavitre, le meneur diabolique du réseau « Footness »… ; la visite des coulisses des loges secrètes…
L’ensemble du récit s’organise autour de deux personnages clés, à savoir Domenn et Vincent. Il n’est pas inutile de présenter maintenant, sans s’y appesantir, ces deux protagonistes, tant ils vont évoluer, non seulement par la force des choses, mais en raison même de leurs réelles aptitudes à l’enquête et à l’espionnage, ainsi que de leur sagacité, dans le sens des parfaits trublions se révélant à même de contrecarrer les plans malsains du réseau « Footness » :
D’abord Domenn y est présenté comme ayant été marqué par une existence laborieuse et difficile, qui a fait de lui un « crève-la-faim de la vie » (p. 29). C’est en se rapprochant du sport, et plus particulièrement du football, puis, plus tard, vers l’âge de 17 ans, du volley-ball, qu’il s’est senti en état de surmonter bien des obstacles et de se réaliser individuellement, et ce malgré les coups du sort, malgré un destin gâché par un milieu social déshérité et une orientation scolaire exempte de sérieux, qui l’ont conduit à devenir, non pas ce sportif pourtant prometteur, mais cet employé de commerce durant une quinzaine d’années. Sa relation au sport a été une relation mêlée d’espoir et de désillusion. Dans le sport – à l’égard duquel, au demeurant, il ne s’est jamais départi -, il voyait tant un moyen de survie et d’épanouissement personnel qu’une réalité-miroir de la société où sévissent violence et injustice. Ses racines permettent d’apporter, selon l’auteur, un éclairage sur sa vision partagée et nuancée du football :
« Enfant d’immigrés slovène et italien, ayant eu des difficultés à s’intégrer dans la société, le foot avait joué pour lui un rôle salvateur, constitué un monde parallèle dans lequel il avait pu se réfugier » (p. 29). Son origine notamment italienne n’était pas sans lien avec sa passion, quoique mesurée, pour le ballon rond. « Du sang italien coulait dans ses veines », précise encore l’auteur à son endroit (p. 45).
Notons qu’à ses racines européennes s’ajoute son authentique attachement à la Bretagne et à son équipe de football (p. 21).
Assurant sa subsistance tantôt par de menus travaux commerciaux, tantôt par la perception de l’allocation chômage, Domenn a réussi, parallèlement, à préparer et à obtenir un diplôme universitaire relatif au sport.
Vincent, lui, y apparaît comme l’ami d’enfance de Dommen, épris, comme son vieux camarade, de football. Sa particularité réside dans le fait qu’il travaille pour un cabinet international de consulting sportif, dont le but affiché est de valoriser l’image du football (p. 34) :
« Mais qui était en réalité ce Vincent omniscient sur le foot et le sport ? Domenn avait revu cet ancien copain d’enfance l’année précédente, en début de saison de Ligue 1, à l’occasion du sempiternel match Stade Rennais -Grand Paris » (p. 21).
Il est à remarquer que, avant de mener une carrière de journaliste sportif, Vincent a songé un instant à sa possible intégration dans le monde du football professionnel :
« Vincent tentera l’expérience professionnelle en signant un contrat d’aspirant-stagiaire au club professionnel local. Mais ce dernier ne connaîtra jamais les joies de jouer devant un public » (p. 31).

Stade de football (courtoisie de B92)
Si, sur le plan du récit, l’intrigue se noue autour de la disparition de Vincent et l’enquête qu’elle va impliquer, elle est également l’occasion de proposer à la réflexion un certain nombre d’interrogations et d’idées pour le moins philosophiques sur la place et le rôle du sport en général, et du football en particulier. C’est en effet autour de la soudaine « évaporation de son camarade » (p. 45) que Domenn va être brusquement conduit à endosser les habits du détective, à approfondir la question du lien entre la disparition de Vincent et les enjeux autour du football, à suivre les méandres filandreux des sombres complots politico-financiers se trouvant au cœur des grands événements sportifs, et à participer finalement à la mise au jour des problèmes insondables de notre condition d’homme moderne dont le monde footballistique en constitue comme le « nœud tragique » (p. 44).
On l’aura compris : outre son lien manifeste avec la tradition du polar, Footness se donne comme un roman à thèse, comme un livre qui suscite, en dernière instance, et de manière féconde, interrogation et réflexion. Et de fait, sur un plan philosophique, au moins deux grandes thématiques, deux grandes idées-force, se dégagent de ce roman étonnant :
1° La thématique du rapport foncier entre football et vie :
Par la bouche de Domenn, l’auteur expose l’idée que : « Le foot ressemble à la vie » (p. 35) ; que : « Le football est semblable à la vie : l’injustice y règne… » (p. 98).
Dans le livre, apparaît effectivement en filigrane, et de manière insidieusement permanente et insistance, l’idée que le football est le haut lieu de l’injustice, le territoire de la reconduction de tous les travers qui se rencontrent dans la société. Dans ces conditions, il y a lieu de voir que l’engouement pour le football vient précisément de sa parenté avec la vie, de son lien étroit avec l’existence banale ; qu’il procède de la reproduction des vices sociaux et de sa fidélité aux mécanismes impurs comme ceux du mensonge, de l’injustice et de la tricherie. Autrement dit, D. Brkić donne à comprendre, dans ce livre, que les gens adhèrent d’autant plus au football qu’ils peuvent s’y reconnaître et réagir selon des schémas déjà intériorisés et largement partagés dans la vie commune. Le succès du football semble, dès lors, résulter, selon lui, précisément du fait qu’il se communique quasi exclusivement comme reflet de la société, dont le propre est que les inégalités et les disparités sociales y sont patentes. Par où l’on voit que, réciproquement, selon le schéma exposé par l’auteur, si le football se proposait d’être le garant de la livraison d’un modèle permettant la réalisation de la justice, il en résulterait alors une dilution des repères sociaux habituels, une inadéquation entre vie sportive et vie sociale, et fatalement une désorientation des supporters qui serait lourde de conséquences : l’établissement d’une équité sportive provoquerait, en effet, au grand dam du sport, une désaffection des milieux sportifs, parce que les supporters et les fidèles ne trouveraient plus ni d’écho ni d’harmonie entre critères sportifs et critères de la vie communautaire. C’est pourquoi, selon pareille optique, il est requis que le principe de pérennisation du sport, et surtout du football, réside dans le maintien de l’inégalité et du déséquilibre.
De là s’ensuivent deux conséquences :
- d’abord, celle que l’auteur nomme tantôt la « popularisation », tantôt la « peopolisation » à travers le football (p. 77). Cette conséquence évoque la volonté de fidéliser le public au football, d’élargir même son filet d’influence et d’emprise, en vue de servir officieusement des intérêts pour le moins financiers et capitalistiques ;
- ensuite, celle que l’auteur subsume sous l’expression de « footballisation du monde » (p. 91), et qui se rapporte à l’adage de ses défenseurs, à savoir que « si Dieu existe, il est à parier qu’il est footballeur » (p. 99). Ce processus de footballisation du monde consiste, en fait, en un puissant « faire-valoir du capitalisme » (p. 91), et se donne, dès lors, comme le parfait pendant de la propagation des idéaux de la dérégulation libérale et marchande.
2° La thématique du rapport complexe entre football et politique :

Stade de football (courtoisie de B92)
Dans le livre, s’affrontent nettement deux visions politiques du football, deux manières antagoniques d’envisager les règles du jeu : d’un côté, on relève les partisans du football tel qu’il se pratique depuis toujours, selon des règles injustes et contestables, où prédominent l’erreur d’arbitrage et les coups bas des joueurs, sur fond de gains financiers pour le moins outranciers qui profitent à ses organisateurs et à ses décideurs ; d’un autre côté, on note les tenants d’un football rénové, où les règles du jeu doivent aussi bien se réélaborer plus sainement et justement, que s’adosser à l’usage des bons côtés de la technique, ainsi de l’aide à l’arbitrage par vidéo impliquant la possibilité de la rétroactivité des décisions de l’arbitre et le renforcement de la fiabilité du contrôle arbitral. Autrement dit, le conflit y oppose les adeptes d’un football empli de l’esprit libéral à ceux d’un football façonné par une éthique sportive. Où l’on voit, dès lors, que si les uns considèrent que la mise sous tutelle du football à des fins de spéculations politico-financières est de nature à alimenter une effervescence sociale et médiatique et à réjouir des supporters subtilement manipulés, les autres estiment, à l’inverse, que la remise à plat des règles du jeu et des conditions d’arbitrage, ainsi que la nécessaire redéfinition d’une éthique sportive resserrée autour des idéaux éducatifs et collectifs sont propres à élever la jeunesse et à lui proposer enfin une conduite respectueuse du vivre-ensemble. Bref, de manière générale, le sport comme redressement et droiture s’y heurte profondément au sport comme dérégulation et marchandisation :
« La philosophie ethno-libérale réutilisée à ce point-là est une théorie servant uniquement les intérêts des classes privilégiées mondialistes éparpillées dans de micro-régions identitaires symbolisées par des clubs omnipotents et un supportérisme fascisant. Dans cette perspective, le foot est utilisé comme anxiolytique d’un monde moderne aliéné. A l’inverse, si la recherche de vérité était érigée en principe universel dans le sport, les gens s’y habitueraient automatiquement. En cette hypothèse, c’est la fonction éducative et citoyenne qui prédominerait. Du coup, les citoyens demanderaient par imitation la même justice dans la vie » (p. 93-94).

Dragan Brkic
Sur le plan politique, cet antagonisme se matérialise par la confrontation entre deux pôles réticulaires, dont les ramifications sont autant nombreuses qu’opaques. Et il y a lieu de constater que l’auteur donne à voir cette opposition, qui est indexée sur deux idéologies contradictoires et irréconciliables, comme la forme d’une bipolarisation des forces en présence, comme le retour d’une coupure irrémédiable entre deux camps ou clans pour ainsi dire en guerre :
« Deux camps s’affrontaient explicitement : celui des ‘vertueux’, potentiellement membres du Réseau, qui étaient pour le changement, présent dans les pays où régnait encore une dimension éthique, comme la France ; et des ‘simplistes’, majoritairement contre, qu’on pouvait inclure dans le mouvement Footness, plutôt situés là où persistait une vision archaïque du sport, comme en Italie, Russie, Angleterre, Autriche et Les Balkans ». Et l’auteur d’ajouter aussitôt : « Si la dissension s’était poursuivie et élargie géographiquement, l’Europe n’aurait pas été loin de redécouvrir les tensions d’un monde bipolaire. En lieu et place de la terreur atomique, on aurait eu la frayeur de la vraie justice… » [c’est nous qui soulignons] (p. 82).
Du théorème de l’auteur selon lequel le football est le miroir de la vie, il s’ensuit que cette guerre entre les deux camps a pour théâtre le cadre de l’existence sociale elle-même, les stades et les rues, les rassemblements populaires dans les espaces urbains, et ce au nom du rétablissement d’une équité sportive ayant dorénavant préséance sur les exigences traditionnelles de l’accomplissement de la justice au sein de la société. Ce recul ou ce déplacement, au sein de la communauté, de la prééminence ordinairement accordée aux valeurs sociales et citoyennes au profit désormais de la primauté de considérations sportives unilatérales ou emblématiquement intéressées porte la marque d’un bouleversement dans la hiérarchie des représentations, et ne manque pas de caractériser la puissance dévastatrice du football quand il est relayé par le pouvoir imbriquant intimement la realpolitik et la finance. Ce déplacement est fortement illustré, dans le livre, par l’inacceptable et injuste défaite de la France face à l’Italie, lors de la Coupe du Monde au Brésil, qui provoqua, très tôt dans le récit, manifestations et heurts hémorragiques :
« D’un coup, des salariés stoppèrent leur travail et sortirent dans la rue en direction des centres-villes. De mémoire de Gaulois contemporain, on n’avait jamais observé de telles foules rassemblées pour la défense d’une cause si éloignée des préoccupations premières. Cela dépassait l’envergure des manifestations pour l’école libre, contre le CIP, le CPE, la réforme des retraites ou le mariage gay » (p. 51-52).
La finale rocambolesque de la Coupe du Monde à Rio caractérise donc, dans le livre, l’étape décisive du franchissement du seuil de tolérance par laquelle non seulement les supporters, mais encore le commun des hommes, n’admettent plus la tricherie et la violation des règles sportives – violation qui sonne dès lors comme la transgression des règles de droit, comme un événement pour ainsi dire criminel :
« Il y avait eu l’agression immonde de Schumacher en 1982, la provocation diabolique de Materazzi en 2006, la main oubliée durant le Championnat d’Europe 2008, l’expulsion infondée du goal à Belgrade en 2009, la paluche vicieuse de Henry contre l’Irlande, les comportements indignes de l’équipe de France en Afrique du Sud et en Ukraine, et le but annulé sur un hors-jeu inexistant contre l’Espagne. Et puis là, le summum de l’injustice, cette insoutenable finale à Rio… » (p. 52).
Au total, ce livre ravira aussi bien les inconditionnels du sport que les philosophes, aussi bien les aficionados du polar que les journalistes sportifs. Dans un style fin et inimitable, Footness lève habilement le voile sur quelques-uns des aspects dramatiques qui entourent la fascination savamment entretenue pour le football et sur le dévoiement consternant de la fonction noble du sport. Tant et si bien qu’en contrepoint de cette peinture d’une réalité crue du football s’y dessinent graduellement les contours de ce que devrait être le sport aujourd’hui.
Footness Dragan Brkić, Éditions Publibook, janvier 2014, 272 pages, 23 €
Footness

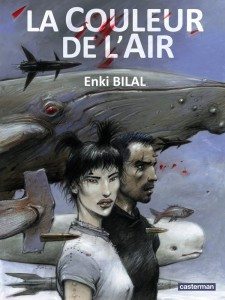





/image%2F1462947%2F20150423%2Fob_4525c2_urien-erika-300x298.jpg)



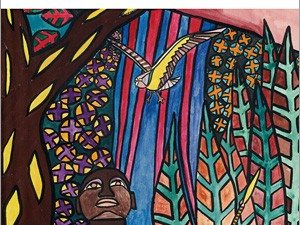










/image%2F1462947%2F20170712%2Fob_12ceb1_533168-3381502171986-172433188-n.jpg)
/image%2F0000001%2F20170712%2Fob_ef69e2_20161001-163330.jpg)